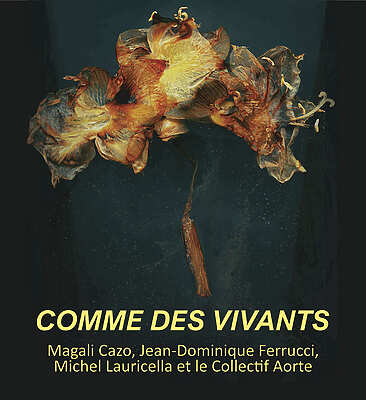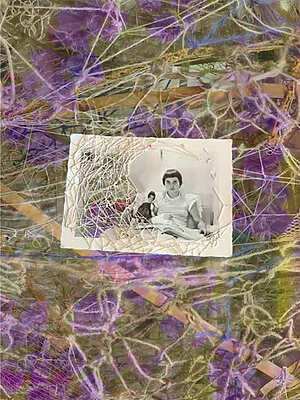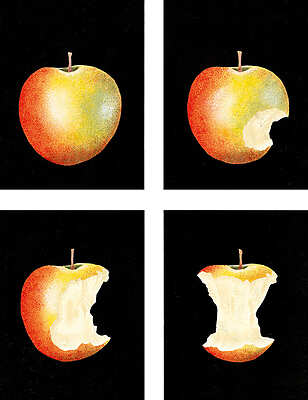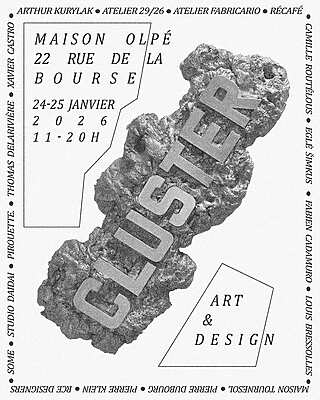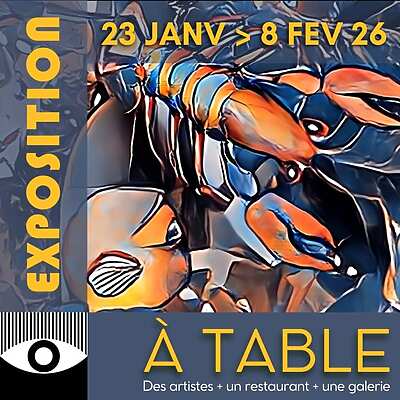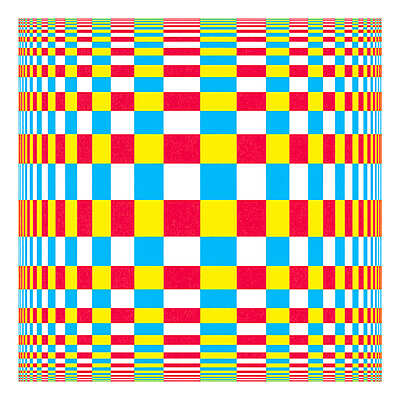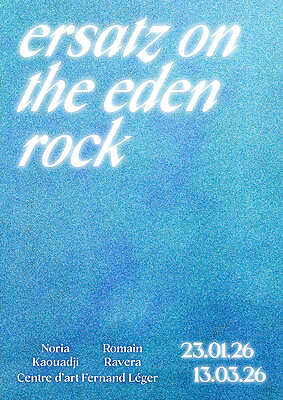Eric Bourret – Le temps long
Jusqu’au 30 mars 2026
Voici un peu plus de trente ans qu’Éric Bourret passe la moitié de son temps à marcher aux quatre coins du monde. À marcher et à photographier. Ou plutôt à marcher en photographiant, à moins que ce soit l’inverse.
Ces deux actes sont en effet chez lui à ce point intriqués, corrélés depuis si longtemps, qu’il serait vain de tenter de distinguer, quant aux expériences qu’ils impliquent et aux objets qu’ils produisent, ce qui relève de l’un ou ce qui incombe à l’autre. C’est ainsi qu’à bon droit on l’aura présenté plus d’une fois sous les traits d’un « artiste marcheur ».
On pourrait dès lors penser que son activité consiste à produire une œuvre de type documentaire, donnant à voir des images de ces lieux plus ou moins familiers, plus ou moins lointains, mais toujours remarquables, qu’il aurait visités. On ne tarderait cependant pas à voir combien un tel jugement est faible et inexact.
Qu’on se laisse happer par la puissance, la beauté, presque monumentale, et le caractère énigmatique de ces images, on s’apercevra en effet que c’est sans doute moins de « lieux », en tant que tels, dont il est question que de ce qu’on pourrait nommer l’archive iconique d’un ensemble complexe de signes qui renvoient tous, de façon délicate, rigoureuse, aux effets du passage du temps comme à une phénoménologie de la durée.
Ceci est sans doute vrai dès le début du travail d’Éric Bourret, mais se déploie de façon spectaculaire dans le corpus rassemblant aujourd’hui des séries d’images rangées sous l’énoncé générique Vortex : Silva proxima (trois mois de marche estivale dans les forêts des Alpes, en France et en Italie (2021-22-23)) ; Jangala (trois mois de marche hivernale dans les forêts primaires des massifs de l’Himalaya (2023-24)) ; Bwa (un mois de marche dans les forêts primaires de l’Île de la Réunion (2024)).
Commissariat, d’Isabelle Bourgeois
Lire la suite...
Après avoir longtemps instruit cette question temporelle en arpentant, jour après jour, année après année, les massifs de la haute montagne, Éric Bourret semble donc avoir réorienté son enquête du côté de la singularité de certaines forêts, celles qu’on qualifie de « primaires », en tant qu’elles sont restées à l’abri de l’activité humaine.
Son pas l’a ainsi conduit à changer d’altitude ou de latitude, à découvrir de nouveaux horizons, mais peut-être surtout à s’éloigner momentanément d’un règne pour aller vers son autre. Comme s’il s’agissait désormais de passer de la contemplation de la matière inerte, somptueuse, pétrifiée, à l’immersion dans l’exubérance quasi illimitée des formes et des textures du monde végétal.
Chemin faisant, son regard s’est tourné naturellement vers les arbres, les troncs, les frondaisons, les canopées, l’ombre des sous-bois. Autrement dit, vers la magnificence opiniâtre du vivant, catégorie qu’Aristote définissait dans ces termes : « Par vie, nous voulons dire la propriété de soi-même se nourrir, croître et dépérir ».
Si cette formule nous retient c’est que, rapportée aux forêts primaires, elle acquiert une portée édifiante. Non seulement, à l’instar de tout vivant, ces forêts disposent en effet de cette « propriété », elle-même au principe de leur émergence et de leur maintien, mais leur longévité et la pérennité de leur existence nous rappellent que ce processus de souveraineté autarcique a débuté et se situe sur une échelle temporelle qui excède infiniment notre faculté de représentation.
Avoir affaire au milieu singulier qu’est une forêt primaire équivaut en ce sens à devenir le témoin, sinon le voyeur in situ, d’une temporalité affranchie de toujours d’un quelconque souvenir. À titre d’illustration, sachant que les plus anciennes traces de l’Homo habilis remontent à environ 2,8 millions d’années, on estime que les fougères des forêts primaires de l’Île de la Réunion, plantes sans fleurs ni graines dont la reproduction s’effectue au moyen des spores, sont apparues voici 130 millions d’années.
Disons alors, pour aller vite, que la vie de ces forêts-là n’a contracté pour apparaître et se maintenir aucune dette auprès des êtres que nous sommes. Marcher, sentir et penser au beau milieu de ces forêts, c’est donc expérimenter rien de moins que le caractère définitivement immémorial d’une origine qui ne sait rien de nous.
Laissons-nous emporter par cette idée, on ne pourra qu’être saisi par un étrange vertige. Mais comment ne pas s’apercevoir en même temps qu’on touche là ce qui est probablement l’essentiel de ce qui définit l’aventure artistique d’Éric Bourret ?
Aborder cette œuvre peut s’effectuer selon une triple perspective. Sans doute d’abord celle qui intéresse la « question temporelle », laquelle, nous semble-t-il, est finalement moins une question, à proprement parler, qu’une sorte de hantise féconde, tant il est vrai que toutes les images d’Éric Bourret se soucient moins d’exposer quoi que ce soit en guise de réponse que d’accumuler et d’agencer les indices matériels liés aux phénomènes de métamorphose et de rémanence.
Sûrement faut-il aussi considérer l’extrême originalité de la production et du traitement de ces images qui les font appartenir au champ de la création plastique bien plus qu’à celui, strictement, de la photographie. Il convient pour finir de ne pas perdre de vue que l’œuvre en question ne se constitue que sous le rapport d’une expérience sensible, mentale, psychique, pensive, dont la dynamique de la marche est la condition première.
Mais en réalité, ce que le souci de l’analyse vient de nous inviter à distinguer s’avère beaucoup plus homogène. Il est clair en effet que cette hantise du temps ne peut s’objectiver qu’au rythme conjoint du déplacement et de la prise de vue ; que la production des images, telle que Bourret la conçoit, s’ensuit chronologiquement et logiquement de la marche,
surtout quand on sait que l’élaboration de chacune d’entre elles procède d’une superposition de clichés successifs, une image résultant du feuilletage que supposent simultanément le tuilage des pas et le séquençage des vues ; et qu’enfin l’acte propre à la marche ne saurait se réduire chez lui à une manière de parcourir l’espace ; si Éric Bourret a choisi de pratiquer son art ainsi, c’est que le fait de marcher rend possible une mise à l’épreuve et une mise au net de la sensation comme de la pensée.
En se déplaçant à pied au cœur des forêts primaires de l’Himalaya, de l’Île de la Réunion ou d’ailleurs, en traversant ces espaces transis par une temporalité quasiment impensable, il nous semble que l’artiste cherche aussi une manière d’approcher — ou de tenir en respect —
ce que pourrait être une généalogie de nature inédite. Non pas, cela va de soi, celle d’un individu, ni même d’une quelconque espèce, mais peut-être celle, infiniment paradoxale, qui permettrait d’envisager, histoire de la récuser, une hypothèse par deux fois aberrante : celle d’un temps-d’avant-le-temps et, symétriquement, celle d’une abolition pure et simple du temps.
Au moment où la question d’une possible disparition de l’humanité se pose dans des termes qui ne relèvent plus du mythe, regarder les photographies d’Éric Bourret, accueillir leur originalité esthétique et la profondeur de leur enjeu, nous incite à penser à nouveaux frais l’éventualité d’une Terre désertée par les hommes.
Face à ces images des forêts primaires, dont il faudrait dire encore la beauté, non exempte souvent d’une mélancolie certaine, nous revient cette remarque si lucide de Claude Lévi-Strauss, en 1955 dans Tristes Tropiques : « Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui ».
Pierre Parlant
Chapelle du Jardin de Baudouvin, Rue des Gibelin, 83160 La Valette-du-Var Tél : 06 07 30 65 23
- Photographie
- - Publié le
- Philippe Cadu