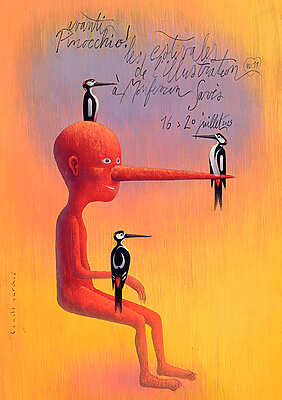Ouvrir les yeux
Les collections photographiques des Abattoirs et de la Galerie Le Château d’Eau
Du 11 octobre 2024 au 18 mai 2025 – Vernissage jeudi 10 octobre à 18h
Pour la première fois les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse et la Galerie Le Château d’Eau offrent aux publics un voyage au sein d’un riche patrimoine photographique encore peu connu. L’exposition présente une large sélection d’œuvres photographiques des collections des deux établissements publics qui toutes deux témoignent des grandes périodes de l’histoire de la photographie et de ses artistes depuis le début du vingtième siècle tout en faisant émerger deux histoires de collections.
Depuis leur création, les collections publiques de ces deux institutions se sont enrichies selon des axes artistiques propres à la nature de l’établissement, l’un – établissement créé en 2000 réunissant un musée et un Frac – dédié à l’art moderne et contemporain, l’autre – fondée en 1974 par le photographe Jean Dieuzaide – pôle emblématique de la photographie moderne et contemporaine de la ville de Toulouse.
Cette exposition, présentée aux Abattoirs, propose un dialogue inédit à même d’offrir un large panorama de la photographie des XXe et XXIe siècles et fait dialoguer aussi bien les plus grands noms que des artistes à découvrir ou redécouvrir comme Hans Bellmer, Claude Batho, Gaël Bonnefon, Mohamed Bourouissa, Brassaï, Sophie Calle, Denis Darzacq, Jean Dieuzaide, Robert Doisneau, Ralph Gibson, Laura Henno, Ouka Leele, Robert Mapplethorpe, Gina Pane, Agnès Varda, Gisèle Vienne, Sabine Weiss, etc. Ces regards croisés mettent également en avant la diversité des approches du médium et la multiplicité des propositions esthétiques, entre photographie documentaire, regards sur l’intime, archives, installations ou encore photojournalisme, au sein desquels se joue un renouvellement de la place du spectateur.
Les photographies, complétées d’installations et d’une sélection de livres d’artistes et d’ouvrages rares issue des riches bibliothèques des deux établissements, jalonneront un parcours construit autour de différentes thématiques imaginé pour faire à la fois émerger les points de rencontre entre les deux collections tout en jouant sur les singularités de chacune.
De l’instantané à la mise en scène, des recherches graphiques voire abstraites aux réflexions sur le corps ou l’espace, des questionnements d’identité aux affirmations de la subjectivité ou à l’exploration des possibilités narratives, ce riche ensemble de près de 300 œuvres finit par développer une réflexion sur la nature et les possibles de la photographie.
Commissariat
Lauriane Gricourt, directrice des Abattoirs
Christian Caujolle, conseiller artistique de la Galerie Le Château d’Eau
Le parcours de l'exposition
Nef – Les corps photographiques
Le corps est un motif largement exploré par la photographie depuis l’apparition du médium. Entre la mise en scène et la mise en pièces, l’objectif fait ressortir la poésie et la mémoire des corps, conjuguant la sensualité et l’érotisme au combat et au traumatisme.
Les oeuvres réunies ici sont des photographies pour lesquelles l’objectif se fait kaléidoscope, fragmentant le corps pour mieux le libérer, le sublimer tout en révélant son histoire ou son identité particulière.
À l’instar de Robert Mapplethorpe ou de Dimitra Dede, le photographe devient sculpteur jouant de la nudité et exprimant une poésie de la chair, parfois jusqu’à l’abstraction, comme chez Kishin Shinoyama. À l’inverse, Gina Pane et Pilar Albarracín révèlent la trace de violences, performées ou subies : la représentation du corps féminin ouvre chez elles sur l’aliénation et les combats nécessaires qu’elle impose.
Ces mises en dialogue inédites font également surgir une mosaïque de formes qui recomposent des identités communes et jouent des stéréotypes allant jusqu’à anonymiser l’individu représenté. Entre réinterprétation et détournement du portrait-robot chez Laurent Lafolie et mise en scène de marionnettes dans la série de Gisèle Vienne évoquant le monde de l’adolescence, le corps devient anonyme, symbole d’un groupe social.
À la manière d’un puzzle, ces corps reflètent une histoire universelle dont ils sont autant de personnages. La photographie s’en fait le support, l’intermédiaire, démultipliant les récits et leur lecture, au travers d’approches constamment renouvelées.
Salle 01 – Sur le vif
Dès les débuts de l’image argentique au XIXe siècle, les photographes ont été obsédés par l’idée d’interrompre le mouvement, de capturer des instants si fugaces que même l’oeil n’arrive pas à les percevoir.
Des scientifiques ou passionnés de technique, comme l’Américain Edward Muybridge (1830-1904) et le Français Étienne-Jules Marey (1830-1904), réussissent à décomposer le mouvement, entre autres celui du cheval au galop ou le vol des oiseaux.
Depuis les années 1930, et grâce au développement de la technique, avec des films plus sensibles et des appareils plus légers, il est possible de saisir des instantanés, des jeux d’enfants de Sabine Weiss à l’envol de pigeons du Toulousain Jean Dieuzaide.
Alors que la presse illustrée en plein essor est friande de leurs clichés, le photojournalisme devient la production majeure des photographes. C’est l’époque des ‘’images à la sauvette’’ chères à Henri Cartier-Bresson (1908-2004). Autour de cette pratique et sous l’influence de la presse naît le mythe d’une photographie objective, ‘’vraie’’.
Des photographes contemporains s’inscrivent dans cette tradition et la revisitent parfois par un détournement de la réalité. Si l’image dépend toujours de ce qui a existé devant l’objectif, certains artistes la fabriquent entièrement et mettent eux-mêmes en scène des situations prises sur le vif. Il en va ainsi de la photographie de performance, chez le duo MWANGI HUTTER, ou des compositions de Denis Darzacq : eux aussi sont les héritiers de cette quête de « l’instant décisif ».
Salle 02 – Réalités parallèles
Si elles remettent en cause la valeur de vérité attachée à la photographie, les images fabriquées sont toujours une invention du photographe et la visualisation d’une image d’abord mentale.
Dans son atelier, un peintre peut par exemple inventer une marine ou un paysage industriel. Le photographe, lui, doit s’ancrer dans le réel : il faut que quelque chose existe devant son objectif et dans l’espace, bien que cette réalité soit fugace.
Parce qu’ils ne pouvaient pas encore ou ne souhaitaient simplement pas reproduire le réel, des photographes choisissent très tôt la mise en scène. Pierre Molinier fait de ses proches les sujets de portraits transgressifs, déformant une réalité finalement malléable.
D’autres, familiers des théâtres des boulevards parisiens, s’inspirent dans les années 1920- 1930 de l’art dramatique et sollicitent des actrices et acteurs célèbres. André Kertèsz, lui, s’en amuse.
Depuis le milieu des années 1970 la mise en scène est redevenue un genre à part entière et une tendance forte. Elle met à mal, non sans humour, les représentations convenues, telles les compositions surréalisantes de Ouka Leele ou de Véronique Ellena.
Les images résultent d’une élaboration subtile et les espaces ou objets photographiés entièrement fabriqués avant de disparaître. Un simple angle inhabituel, un reflet, ou la mise en couleurs incongrue d’une image en noir et blanc peut également suffire à nous surprendre et arrêter le regard.
Entre fiction et réalité, ces photographies contribuent au réenchantement du monde, voire du quotidien.
Salle 03 – Sublimer le banal
En 1967, l’exposition ‘’New Documents’’ au MoMA (New York) célèbre un nouvel élan de la photographie documentaire, courant apparu dès le XIXe siècle.
Il ne s’agit pas d’abandonner toute volonté plastique, mais de prendre de la distance par rapport à une dimension uniquement artistique. Parfois politique, parfois neutre, davantage esthétique, cette approche célèbre la scène du quotidien, de l’ordinaire – ou de ’’l’infra-ordinaire’’ dont parle le romancier Georges Perec (1936-1982).
L’ordinaire devient le sujet principal de ces photographes qui s’intéressent désormais aux non-événements. On y retrouve quelque chose du ready-made de l’artiste Marcel Duchamp (1887-1968) : les objets usuels se suffisent à eux-mêmes, et les situations anodines sont sublimées par le cadrage, la lumière, ou la couleur.
Après les années 1960-1970 qui voient l’apparition d’un véritable foisonnement d’images, les années 1990 et le développement du numérique favorisent de plus belle leur multiplication.
Tout devient alors sujet : il s’agit de se familiariser avec le quotidien, et le travail amateur s’en trouve valorisé grâce à des appareils abordables et aux téléphones portables.
On assiste à l’émergence d’une forme d’expression descriptive mais également poétique.
La spontanéité de l’acte de photographier et son accessibilité en font le témoin d’une banalité reconquise : Seton Smith ou Gaël Bonnefon réactivent les natures mortes classiques, comme Claude Batho, tandis que Géraldine Lay s’attarde sur des scènes ordinaires, “scènes de genre” glanées dans l’espace public au profit d’une nouvelle histoire de l’art.
Salle 04 – L’art et la matière
Dans leur quête constante d’innovation esthétique, les photographes effectuent parfois un retour aux formes plus académiques de la peinture, du dessin ou de la sculpture.
Qu’ils réinterprètent les grandes thématiques de l’histoire de l’art, ou s’intéressent à la matière, à la composition, leur pratique s’affirme comme une contre-culture.
Ils mêlent la photographie aux installations, à l’artisanat ou même, dans la veine du surréalisme fondé en 1924, au collage comme Dominique Roux. Aujourd’hui, elle sert de matière première à de nouvelles propositions plastiques qui se nourrissent de sa dimension documentaire.
En s’inscrivant dans des oeuvres comme celles de Libia Posada ou de Pierre Leguillon, la photographie n’est plus seulement une trace, mais le reflet vivant et souvent critique de la société. Zanele Muholi et ses nouvelles icônes queer ou encore Mohamed Bourouissa recentrant l’objectif sur les périphéries, font également exploser les codes en l’abordant comme un outil politique et de revendication.
Ces artistes se réclament parfois même davantage plasticiens que photographes. Ils composent des images aux allures de tableaux, où la lumière, le cadrage, le support renvoient à une esthétique picturale, épousée par Elina Brotherus ou Jean-Marc Bustamante.
Ils s’assurent également que la reproductibilité de l’oeuvre prônée par le philosophe Walter Benjamin (1892-1940) en 1935 redevienne une possibilité. Ces photographes revisitent les grands genres de la peinture, de la peinture d’histoire à la scène de genre, ou au portrait.
Salle 05 – La Fabrique du soi
Le portrait est peut-être le domaine dans lequel la photographie a eu le plus de mal à se dégager de l’influence de la peinture et de son esthétique. Dans la représentation de l’autre et dans celle de soi-même, s’exprime une quête dont les codes constituent autant de facettes, sujettes à des métamorphoses infinies.
D’abord intense activité commerciale au XIXe siècle, au service d’une bourgeoisie triomphante, le genre, dont la police et la justice s’emparent très vite, devient également une pratique artistique à part entière.
Un portrait résulte d’une confrontation entre un individu qui souhaite contrôler, composer et immortaliser son image et son auteur, souvent désireux d’affirmer son point de vue. D’aucuns recherchent une neutralité relative et d’autres, entre interprétation psychologique et intérêt pour la forme, sociologie et ethnologie, s’interrogent sur le sens et la fonction de leur interprétation.
Certains portraits naissent du dialogue entre le photographe et son modèle, d’autres poussent le sujet dans ses retranchements, ou bien sont saisis sur l’instant. Il s’agit toujours de questionner ou d’affirmer l’identité du modèle, et de révéler sa forme au moyen de la lumière.
Ici se côtoient des portraits célèbres, d’André Malraux (Gisèle Freund), ou d’anonymes (Jean-Louis Garnell). Ils incarnent une époque, un évènement – le bombardement d’Hiroshima (Hans Silvester) – ou une communauté, queer chez Pauline Boudry & Renate Lorenz. Souvent à rebours des règles, le photographe les détourne et le portrait s’applique alors à la nature, à l’inanimé.
Salle 06 – Double Je
Depuis le célèbre Autoportrait en noyé (1840) du pionnier de la photographie Hippolyte Bayard (1801-1887), le genre de l’autoportrait n’a cessé de traverser la création photographique.
S’il se rattache à une tradition picturale, il permet de multiples expressions et ne cesse d’être revisité par les artistes en quête de transformation – voire de transformisme.
La mise en scène de soi répond en effet à des ambitions à la fois esthétiques et politiques, au coeur d’une recherche sur l’identité. Chez Pierre Molinier, l’identité sexuelle est en jeu et l’autoportrait, le théâtre de ses travestissements.
Placées sous le signe de la provocation, ses oeuvres engagent une réflexion inédite sur l’identité et les stéréotypes sociaux et culturels, qui trouvent notamment écho dans l’oeuvre d’Ouka Leele ou de Sory Sanlé.
Une certaine dimension narcissique s’empare ailleurs du genre, démultipliée chez Gilbert Garcin. Elle introduit le débat autour de la perception de la beauté, au coeur des expériences d’ORLAN.
L’identité culturelle a, enfin, son rôle à jouer : les costumes, les bijoux ou les maquillages traditionnels ou, à l’inverse, la nudité, deviennent les accessoires de la théâtralité d’Alexander Apóstol d’abord, de Léa Crespi ensuite. Ces choix font du photographe un anthropologue, un explorateur de l’altérité : le « double je » est aussi un « autre » portrait, sa métamorphose.
En plasticien, l’artiste se joue du reflet, du dédoublement ou de la superposition au profit d’expériences visuelles, ouvrant la photographie à de nouveaux champs.
Salle 07 – Perspectives – Lieux
Toute photographie implique un cadrage. Si l’on dit souvent qu’elle prélève de l’espace, il serait plus juste de dire qu’elle invente un espace et crée un hors-champ, superposant lignes de fuite et lignes de force dans une chorégraphie savamment orchestrée.
Des photographes aux approches graphiques et esthétiques très différentes nous proposent ainsi de contempler des scènes qui sont d’abord le fruit de leur regard. Urbains ou naturels, les paysages ici présents portent tous la marque de l’humain, au-delà du seul cadre choisi. De la guerre (Mathias Bruggmann) à l’agriculture, formelles ou poétiques, ces images sont la transcription de ce qu’éprouve le photographe lorsqu’il parcourt l’espace.
Certains optent pour la description, la frontalité, et intègrent des éléments graphiques tels des fils électriques généralement perçus comme disgracieux (Gabriele Basilico). D’autres s’amusent d’étrangetés et des perspectives qu’offre notre environnement (Eva Nielsen).
Ils s’attachent à un détail, jouent sur l’échelle, composent des variations musicales autour d’un même décor. Enfin, certains interrogent la tradition du paysage qu’ils perturbent d’éléments incongrus, ou font référence à la peinture en jouant sur de subtiles variations de la couleur.
Entre le plaisir du regard et la rigueur de l’exploration, c’est la photographie qui est au travail. De l’esprit des lieux au partage d’émotions, la perception évolue en fonction de la lumière, sombre, éclatante ou onirique, comme chez Matt Wilson, et ce quelle que soit l’étendue du territoire considéré.
Salle 08 – Perspectives – Lignes
Entre les géométries trouvées et fabriquées, s’agit-il de pallier les désordres du monde ou de les souligner ? Tout dépend, comme toujours, de l’intention du photographe.
À partir de 1930, Brassaï se met en quête des graffitis qui couvrent les murs des villes : il révèle d’innombrables visages, béats ou torturés, et quantité de signes, amoureux, graphiques, ou revendicatifs.
Ces lignes gravées par des mains anonymes, se superposent à celles naturelles de la surface des murs. Elles évoquent combien la photographie n’est jamais qu’une façon de rappeler que nous sommes d’abord face à une image, prise en toute conscience, et qu’elle affirme sa subjectivité en jouant avec des bribes du réel. La confrontation de ces répertoires de formes trahit une volonté de composer et de produire des images équilibrées, qui n’est plus aujourd’hui un carcan.
Comme Jochen Lempert, certains s’en amusent pour construire des séquences ou des alignements dont le rythme importe autant que la composition, dans une géométrisation de l’espace. D’autres jouent de l’ombre et des contrastes pour tracer des lignes partout où il est possible de les trouver : les corps en deviennent le théâtre chez Ralph Gibson, Liliana Porter ou les danseurs éreintés d’Émilie Pitoiset.
Les lignes sont aussi celles que trace la nature dans le ciel, avec des nuages ou l’explosion d’un geyser surpris par SMITH, que l’humain construit en élevant des bâtiments, ou encore en transformant les paysages en profondeur.
les Abattoirs, 76 allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse . Tél : 05 34 51 10 60 (accueil musée).
Ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 18h – Nocturne tous les jeudis soir jusqu’à 20h
Ouverture les samedis et dimanches de 10h à 18h