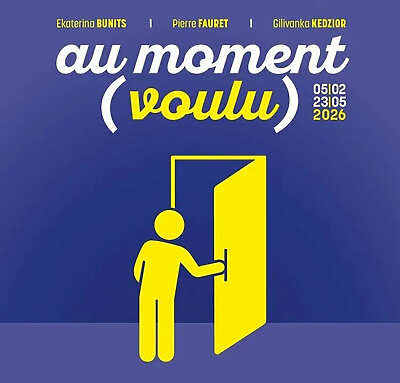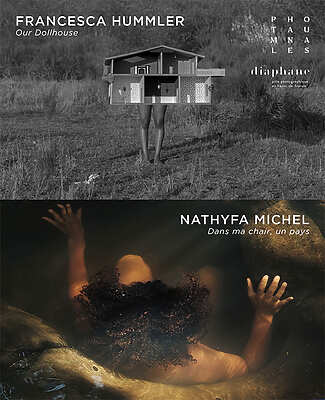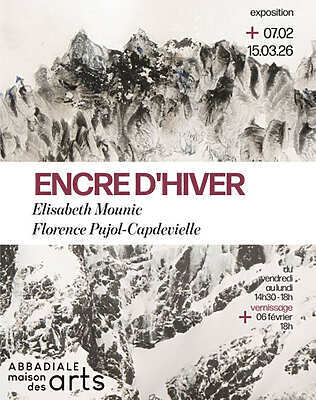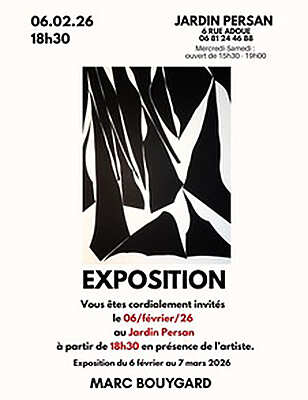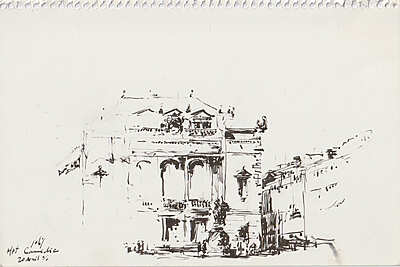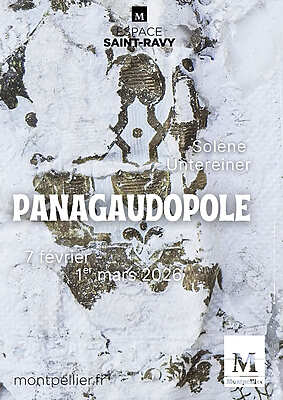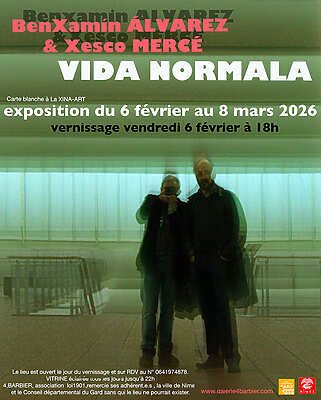Philippe Cognée – L’œuvre du temps
Du 21 juin au 2 novembre 2025
Pour la première fois, le travail de Philippe Cognée est envisagé dans sa globalité sous le prisme de son rapport au temps Pourtant, cette thématique essentielle imprègne profondément la large sélection d’œuvres qui est présentée dans les espaces du musée Paul Valéry, couvrant une période s’étendant des années 1980 à nos jours
Ce rapport au temps se manifeste tant dans la récurrence de motifs en dialogue avec l’histoire de l’art que dans la dimension mémorielle ancrée au cœur de sa technique Sa peinture à l’encaustique, qui déforme et altère les images issues de la photographie et de la vidéo, confère à son œuvre une temporalité palpable, reflétant les effets subtils de la durée. Aux côtés de figures comme Baselitz et Richter, Philippe Cognée s’impose parmi les artistes qui savent traduire visuellement notre perception contemporaine du temps
Si elle peut être balisée par la chronologie, l’œuvre d’un artiste se développe pourtant dans une temporalité complexe et hétérogène, où les ruptures apparentes dissimulent fréquemment des métamorphoses Dans une telle optique, la question du temps est apparue comme un prisme à travers lequel prennent sens les multiples dimensions de l’œuvre de Philippe Cognée
C’est à partir de cette notion que se sont structurées les réflexions croisées de l’artiste et d’Olivier Weil, commissaire scientifique de l’exposition, qui y ont vu un cadre pertinent pour appréhender la complexité de l’œuvre et en révéler les dynamiques internes. Au musée Paul Valéry a été privilégiée une approche ouverte mais cohérente. Si les pièces tridimensionnelles en ont été écartées, l’exposition embrasse l’ensemble de la production picturale de Philippe Cognée, tout en ménageant des incursions ponctuelles dans l’univers du dessin ou du livre, lorsque l’occasion était donnée d’enrichir le propos général
« Philippe Cognée. L’œuvre du temps » offre ainsi une vision inédite de Philippe Cognée, en dépit de la diversité de ses séries et de ses médiums Loin de se limiter à une simple évolution stylistique, elle propose une immersion dans une réflexion profonde sur le temps, la transformation et l’effacement. La peinture de Cognée, entre dissolution et émergence, devient un lieu où la mémoire, la perte et la persistance s’entrelacent, nous offrant une expérience unique de contemplation et de réflexion.
Sous le commissariat de Stéphane Tarroux, Directeur du musée Paul Valéry et Olivier Weil, commissaire scientifique associé.
L’image de soi, miroir du temps
Bien que peu nombreux au sein de sa production, les portraits occupent une place essentielle dans l’œuvre de Philippe Cognée. Ils traduisent une réflexion profonde sur l’identité, le temps et la perception de soi L’artiste y revient régulièrement, porté par une obsession : celle de saisir ce que le philosophe Jean-Luc Nancy nomme le « sujet absolu » , c’est-à-dire un individu affranchi de toute extériorité, recentré sur sa seule existence.
C’est pourquoi les figures représentées apparaissent souvent isolées, parfois dénudées, dans des cadrages serrés qui privilégient le visage — nu de toute expression qui viendrait trahir une intention narrative
Les autoportraits exemplifient cette quête d’identité. Philippe Cognée s’y livre entièrement, tentant par l’opération de la peinture d’atteindre les fondements de son être et de son moi profond.
Dans certains d’entre eux, l’image de l’artiste-sujet y apparaît sans aucun artifice ; dans d’autres, elle s’inscrit dans une mise en scène qui n’a pour fonction que de révéler, sur un mode métaphorique, des traits de son caractère ou des préoccupations qui l’habitent Quels que soient le format et la technique utilisée, le regard joue un rôle central dans la composition.
Il incarne la pulsion scopique de l’artiste aux prises avec lui-même. Qu’il soit dirigé vers le spectateur ou pris dans une relation spéculaire avec sa propre image, son pouvoir d’aimantation nous entraîne dans une introspection qui se joue des aléas de la vie et des vicissitudes du temps.
Peindre pour sauver de l’oubli
Au cours des années 1990, Philippe Cognée se tourne vers d’autres sources d’inspiration et change radicalement sa manière de peindre Son attention se porte sur les objets et les scènes du quotidien : les immeubles du quartier de la périphérie de Nantes où il vit alors, les repas entre amis et les vacances en famille, le mobilier et les appareils électroménagers qui l’entourent, les moments marquants de ses déplacements en train et de ses voyages avec ses proches, sa femme Sandrine, ses deux fils Thomas et Guillaume, et son chien Indy.
Dans ces scènes, l’avant, le passé, le révolu sont actualisés par la peinture qui fixe dans des images d’une étonnante présence des instants que la banalité ne pouvait que condamner à l’oubli
La liberté dans le choix des motifs et la découverte de la capacité qu’a la peinture de cristalliser la tension entre souvenir et oubli se manifestent en particulier dans trois séries de photographies de taille modeste, recouvertes de peinture à l’huile, qu’il réalise entre 1991 et 1995.
Ces ensembles, constitués chacun de plusieurs centaines de « petits tableaux », jouent un rôle pivot pour son œuvre à venir. Ils représentent en effet un réservoir de motifs, de formes et de compositions dans lequel il n’aura de cesse de puiser ; de plus, c’est en peignant sur la surface lisse du papier photographique qu’il découvre la qualité très particulière de la peau dont il décide dès lors de revêtir ses tableaux.
L’usage de la cire floutée au fer à repasser va lui permettre d’obtenir l’aspect poli qu’il recherche et dont il va pouvoir, grâce à cette technique, explorer toutes les possibilités.
À l’origine : le labyrinthe
Les années 1980 sont pour Philippe Cognée des années d’apprentissage au cours desquelles il développe un langage plastique nourri, d’une part, des sensations et des images emmagasinées lors de son enfance passée en Afrique et, d’autre part, des univers mythologiques et préhistoriques dont il découvre la force et la portée
La figure du labyrinthe dont la structure et les significations le fascinent lui offre un cadre idéal pour dérouler une iconographie riche en créatures imaginaires et expérimenter techniques et matériaux.
Son style est alors fortement empreint de primitivisme et d’une rudesse qui s’expriment aussi bien dans des dessins que dans des peintures, des reliefs en bois et des sculptures
« À vos débuts, dans les années 1980, tout un bestiaire se dessine dans vos peintures, qui disparait par la suite. Venait-il du Bénin où vous avez passé votre enfance, des mots de Guillaume Apollinaire, de la vie à la campagne ? Et pourquoi a-t-il disparu ?
Ce bestiaire s’est imposé à moi à la fin de mes études aux Beaux-Arts. J’ai vécu 12 ans en Afrique, entre mes 5 et mes 17 ans. À l’âge où l’on va à l’école primaire, j’étudiais à la maison. Mon père était professeur, nous donnait des devoirs à mon frère et à moi, et ma mère nous faisait travailler.
Au Lycée Béhanzin, à Portonovo, j’étais dans une classe d’élèves béninois, et j’ai eu du mal à trouver ma place. A mon retour, je suis entré en terminale, puis à l’École des Beaux-Arts à Nantes. Et à nouveau j’ai éprouvé certaines difficultés, j’étais toujours un peu à côté – j’y ai passé 7 ans au lieu de 5, je n’étais pas mûr. J
’étais très indépendant, je vendais des aquarelles au marché pour pouvoir travailler sur mon œuvre. Et, à partir de ce moment-là, je n’ai plus été inquiet ni pressé, j’ai compris que les fruits ne mûrissent pas tous en même temps. Dans ces années d’après Mai-68, il ne fallait plus peindre, or je voulais faire de la peinture. Mon projet était clair.
Ces animaux criaient peut-être ma volonté d’exister, une forme de sauvagerie et de rage, des bêtes et des gens qui semblaient hurler « j’existe ». Évidemment je me nourrissais d’histoire de l’art, de mythologie grecque, de contes d’Afrique, de Guillaume Apollinaire, d’André Masson, du Douanier Rousseau, mais aussi Georg Baselitz et Mimmo Paladino…
Et puis l’idée du labyrinthe est apparue, avec cette peinture d’un serpent. Je voulais faire resurgir la mémoire d’une africanité vécue. Il y a aussi l’idée d’un cycle, perçu à travers des saynètes, une opposition totale entre deux éléments.»
Extrait de l’entretien de Philippe Cognée par Anaël Pigeat, Sète, 2025.
Musée Paul Valéry, Rue François Desnoyer, 34200 Sète Tél : 04 99 04 76 16
- Arts Plastiques
- - Publié le
- Philippe Cadu