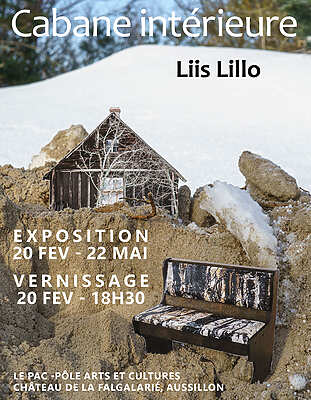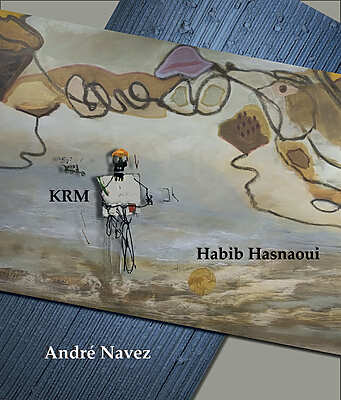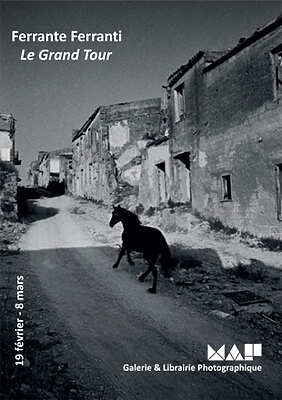Nicolas Cussac – Petite rétrospective
Du 21 juin au 30 septembre 2024
Nicolas Cussac investit cet été les grandes salles de l’ancienne magnanerie du Château de Jau. Invitation rare pour un enfant du pays – il a vécu toute son enfance à Estagel – dans un lieu qui a vu passer depuis 1977 certains des peintres les plus réputés de leur temps, tels César, Antoni Tàpies,
Olivier Debré, Shirley Jaffe, Robert Combas, Vincent Bioulès, Gérard Gasiorowski, Bernard Dufour…
Faisant suite à un parcours en trois étés successifs dans l’œuvre foisonnante de Vincent Corpet, Nicolas Cussac, né en 1964, présente une rétrospective perlée de son travail, en particulier trois séries composant le Lavabo (2006-2007), le Divan (2008), et la Cuisine (2011-2013).
A ces trois séquences, s’ajoutent des paysages et scènes d’intérieur, peintures représentatives de son travail actuel, réalisées dans la perspective de cette exposition, dont certaines à Jau même et alentours.
Invitation à une flânerie intemporelle dans ce bel espace posé entre les vignes et le restaurant du domaine.
Cussac à Jau
Mon voyage en peinture a démarré vraiment après avoir été frappé, dans une exposition consacrée à l’œuvre de Lucian Freud à la Caixa Forum de Barcelone à la fin 2002, par le tableau d’un vieux lavabo, l’eau coulant de deux robinets, qu’il avait peint au milieu des années 1980.
Son réalisme, sa lumière, m’avaient frappé instantanément.
Mais ça a infusé longtemps. Ce n’est que quelques années plus tard que j’ai réalisé la série de huit tableaux de même format, selon un cadrage répétitif, centrée sur le lavabo de ma salle de bains. Malgré sa banalité apparente, cet objet pouvait devenir le centre d’un monde, le lieu d’un voyage possible par la peinture.
Confusément, cette série, qui m’a occupé plusieurs mois, puisait probablement aussi sa source aux quelques années durant lesquelles, après mon passage aux Beaux-Arts, j’ai habité chez mon grand-père. C’est une maison où j’ai beaucoup dessiné, innocemment, et j’ai réalisé après sa mort qu’un monde avait disparu avec lui, dont mes dessins étaient l’ultime trace.
J’ai le sentiment que mon travail, les séries que j’ai peintes ensuite, portent la marque d’une certaine nostalgie, de la conscience d’une fragilité, d’une fugacité, d’une disparition prochaine inéluctable, et en même temps du plaisir éprouvé à habiter pleinement une maison. A sentir, au coeur du silence, la respiration du lieu, à épouser ses plus subtiles vibrations. Et approcher ainsi de son centre de gravité.
Après le lavabo, le voyage s’est poursuivi avec le divan, puis dans la cuisine. Avec une application artisanale, la volonté d’un apprentissage patient au métier de peindre. Lorsque je parviens à faire le vide en moi, que mes voix intérieures s’apaisent, ça amène une tranquillité qui me permet de me consacrer pleinement aux choses, aux personnages qui m’entourent, me visitent, prennent le temps d’une pose, d’une pause… Plus on est capable de faire silence, plus on se met à disposition de ce monde-là. Et en mesure de goûter à son étrangeté.
Par la suite, avec le retour au dessin, est apparue une forme de décontraction, de nonchalance. Lorsqu’on cherche à retenir l’émotion d’un instant, on est tenu d’aller à l’essentiel. C’est venu naturellement, en allant me frotter au paysage. En peignant parfois sur le motif. Puis en dessinant spontanément, très vite, dans de petits carnets et en prenant ces croquis, qui vont à l’essentiel, comme ossature des tableaux en atelier, tout en cherchant alors à conserver la vivacité, l’énergie de l’émotion première.
Plus la peinture tend vers la légèreté, plus on est dans la transparence, plus on s’affranchit des détails, plus cette impression persiste. Rien ne me semble plus émouvant que la première trace, y compris lorsqu’il lui arrive d’être maladroite, approximative. Ce côté intact, intouché, laisse affleurer la fragilité.